Volume 2, numéro 1 – 2025. Un tournant afro dans l’analyse du discours au Brésil?
Verbétisation et désignations dans le Dictionnaire des favelas Marielle Franco
Vanise MEDEIROS
Dans la perspective que je considère, [les instruments linguistiques] sont donc des objets linguistiques historiques qui donnent forme aux relations sociales. Ils façonnent la relation du sujet avec les autres sujets et avec la formation sociale, signifiant ainsi ces relations sociales (Orlandi, 2002, p. 163).
Malheur à celui qui rompt ce pacte du silence bavard : il risque de devenir ipso-facto un spectre visible de l’adversité (Pêcheux, 1990, p. 15).
Un commencement
Un retour vers André Collinot et Francine Mazière (1997) n’est jamais de trop, notamment lorsqu’ils signalent dans leur livre qu’ils considèrent le dictionnaire comme un discours. Dans la même veine théorique de base discursive, José Horta Nunes proposera la notion de « dictionnarisation » :
Nous appelons dictionnarisation le processus historique et discursif de constitution des dictionnaires. Pour comprendre l’histoire du dictionnaire, nous considérons qu’il est nécessaire de prendre en compte ses techniques de base d’élaboration, de sorte qu’une simple liste de mots est vue comme conditionnant ce qui deviendra plus tard un dictionnaire (Nunes, 2006, p. 45, italique de l’auteur)
C’est en suivant ces traces théoriques et leur impact sur la lecture des instruments linguistiques que nous proposons dans cet article une réflexion sur la notion de « mise en entrée » ou « verbétisation » (verbetização), un processus qui transforme des signifiants[1] sélectionnés comme items lexicaux en entrées d’instruments linguistiques au sein d’une formation sociale. Un tel processus est une pratique sociale, historique et idéologique. Dans le sillage de Monica Zoppi Fontana et Josefina Ferrari (2017), Mariana Cestari (2017) et Rogério Modesto (2021), nous considérons qu’il s’agit d’une pratique genrée et racialisée, qui invite à l’écoute sociale, dans la lignée de Michel Pêcheux (2011).
Les réflexions que nous développons ici s’inscrivent dans le champ de l’histoire matérialiste des idées linguistiques, un domaine de base discursive. Pour situer ce domaine, il est nécessaire de se référer à Sylvain Auroux (1992) et Eni Orlandi (2001)[2], un auteur et une autrice dont la rencontre a abouti à cette composition théorique. Cet article s’appuie également sur des études comme celles, parmi d’autres, de Patricia Hill Collins (2019), Achille Mbembe (2018) et Lélia Gonzalez (2020), qui permettent une réflexion sur les pratiques sociales traversées par les mémoires colonialistes au Brésil. Cela étant dit, cet article a pour objet d’étude le Dictionnaire des favelas Marielle Franco, plateforme collaborative en ligne lancée en avril 2019 qui réunit des activistes, des collectifs des favelas et des universitaires (www.wikifavelas.com.br) afin de permettre une meilleure connaissance de la question des favelas, et analyse des entrées qui touchent à la désignation des habitants des périphéries urbaines. Nous souhaitons donc contribuer aux réflexions qui puissent faire avancer les études sur la décolonisation linguistique.
Réflexions autour de la mise en entrée (verbetização)
Dans le cadre d’une approche discursive, un des aspects importants du traitement analytique réside autant dans ce que la lecture de son objet ramène à la théorie que dans ce que la lecture théorique permet d’observer en lui. Notre réflexion sur le processus de mise en entrée résulte d’un ancrage dans l’histoire des idées linguistiques, et dans les liens qu’elle a tissés avec l’analyse matérialiste des discours au Brésil, c’est-à-dire d’une attache à ses concepts et à ses pratiques analytiques. Notre réflexion est également le produit d’allées et venues vers l’objet[3], lectures qui font bouger le champ théorique. Dans cette optique, il est intéressant d’analyser ce qui compose une entrée. Nunes signalait déjà que « […] la configuration interne des entrées produit du discours » (2006, p. 34). J’ajoute que ces sélections de signifiants qui se constituent comme entrées sont également des discours. Les deux produisent des effets de sens. Sélectionner une entrée est un geste social, historique et idéologique : on ne sélectionne pas n’importe quel signifiant pour figurer dans les instruments linguistiques. Il y a une historicité de ce qu’on (peut) sélectionne(r) ou non. Il y a des interdictions et des effacements dans un tel geste. Une entrée instaure un lieu de dire à son sujet, ou plutôt, elle demande des dires qui reviennent vers elle. Une entrée ne se sépare pas de l’espace lacunaire qui s’ouvre à partir d’elle et se tourne vers elle, espace de la glose, du commentaire qui fonctionne comme définition. À propos de la définition, il faut rappeler, suivant les traces de Nunes (2024), qu’elle n’est pas sans « positionnement de production de connaissance » (p. 158). Il en va de même pour la production et/ou la sélection d’exemples dans les instruments linguistiques. C’est en prenant en compte de telles relations que l’on peut penser au processus de mise en entrée dans le champ discursif matérialiste. En d’autres termes, je considère que le processus de sélection et de configuration de signifiants dans les dictionnaires ne se fait pas sans prise de position dans la production des connaissances qui inscrivent ou taisent les savoirs dans les formations sociales. Pour exposer une telle notion, je ferai appel aux études de Jonathan Moura (2018; 2020), qui se situent dans le champ discursif.
Dans sa thèse sur le dictionnaire Aurélia[4], Moura (2018) établit une distinction entre les termes dictionnariser et mettre en entrée (verbetizar). Le premier est « légitimé par un lexicographe » et « endossé par une institution » (p. 153). Le deuxième provient d’espaces non institutionnalisés et non autorisés par la tradition lexicographique. Dans un texte postérieur, Moura (2020) élargit la notion de manière à inclure des situations de paroles, comme la salle de cours ou les conversations où sont produites des définitions, et précise que « c’est dans la langue courante que naît la mise en entrée, que ce soit dans l’oralité, dans l’écrit ou dans le numérique » (Moura, 2020, p. 125-126). La mise en entrée et la dictionnarisation sont donc des pratiques aux statuts différenciés, selon les lieux où elles se produisent : « La mise en entrée se produit de manière fluide, en valorisant la langue courante, alors que la dictionnarisation se situe dans des rituels institutionnels qui valident certains vocables comme faisant officiellement partie de la langue » (Moura, 2020, p. 127). Cela touche donc à la légitimation ou non de vocables ou d’expressions. Ses réflexions éclairent sans aucun doute le processus de mise en entrée en tant que pratique sociale du quotidien : de l’oralité, de l’écrit et du numérique. En ce sens, je rappelle ici que la sélection de signifiants comme signes autonymiques et leur définition sont des pratiques courantes, qui s’exercent également à partir d’un imaginaire du dictionnaire. Il importe aussi de souligner que le dictionnaire Aurélia s’organise comme un instrument linguistique et, je dirais, comme un instrument de lutte LGBTQIAP+[5]. Produire un dictionnaire comme Aurélia, c’est tracer un lieu dans la langue qui se met en scène en tant qu’instrument linguistique, tout comme le fait l’objet que j’étudie : le Dictionnaire des favelas Marielle Franco. Le dictionnaire Aurélia est un instrument de lutte dans lequel s’inscrit la problématique tendue du genre, marquée par les censures et les mises sous silence (im)posées par la société. Même s’il n’est pas un instrument de référence comme le dictionnaire Houaiss, il s’agit d’un lieu de « stabilisation des sens », comme l’indique Nunes (2013, p. 163)[6], un espace qui jette une lumière sur une réflexion importante pour l’analyse de notre matériau, c’est-à-dire la distinction entre savoirs assujettis et savoirs qui assujettissent (cf. Medeiros, 2024[7]).
Pour situer une telle distinction, il est nécessaire de reprendre la notion de savoirs assujettis proposées par Patricia Hill Collins (2009), qui critique la notion chez Foucault. Collins soutient que la pensée féministe noire ne constitue pas un « savoir naïf », mais des savoirs tenus pour naïfs « par ceux qui contrôlent les processus de validation du savoir » (Collins, 2009, p. 42). Les savoirs assujettis sont donc ceux sans légitimation dans la société. Partant de ses travaux, je propose une différenciation entre savoirs assujettis et savoirs qui assujettissent. Malgré la ligne subtile qui les sépare, je comprends, dans la lignée de Collins, par savoirs assujettis des processus de mise sous silence des savoirs de l’autre. Les savoirs assujettis tiennent de la disqualification épistémique de l’autre. Quant aux savoirs qui assujettissent, je me réfère aux savoirs qui ne sont pas tus, qui, au contraire, circulent dans notre société et fonctionnent de façon à assujettir l’autre. Les deux donnent corps à des pratiques nécropolitiques (Mbembe, 2018) et disqualifient l’autre : avec le premier, on met en jeu le savoir de l’autre, avec le deuxième, on disqualifie l’autre indépendamment de son savoir. Une telle distinction trouve son origine dans la lecture des entrées du dictionnaire Marielle Franco. Je reviendrai plus tard sur ces notions.
C’est à partir de ces espaces d’instrumentation linguistique, qui ne s’inscrivent pas comme des instruments de référence, qu’a été proposée la notion de mise en entrée[8]. Pour résumer, en ce qui concerne cette notion, Moura a contribué à l’observation du geste dictionnairique dans plusieurs pratiques du quotidien, mais il s’agit toutefois d’une notion distincte de celle que je développe. Je crois que les deux contribuent à une réflexion portant sur la production de connaissances.
La notion de mise en entrée que je propose trouve son origine dans mes lectures du Dictionnaire des favelas Marielle Franco. J’y ai rencontré des entrées comme élément suspect (elemento suspeito) (Medeiros, 2024a), que j’ai cherchées dans le grand dictionnaire de langue portugaise, le Houaiss. On y trouve seulement l’entrée élément et ses diverses acceptions ne renvoient pas à quelque chose d’aussi connu dans la violence quotidienne brésilienne, qui entraîne le décès d’« éléments suspects ». Nunes (2006) interroge la manière dont les dictionnaires produisent des discours. Partant de sa pensée et ce que j’ai pu lire dans le Dictionnaire des favelas Marielle Franco, je me suis demandé si le geste de sélectionner des entrées était aussi discours. Un dictionnaire est toujours incomplet, un non-tout, malgré l’illusion que, dans un grand dictionnaire de langue, un tout de la langue y serait présenté. En somme, le fait de figurer ou non dans les instruments linguistiques de référence est discours. La sélection est discours : on met en lumière certains mots, certains syntagmes; on en tait d’autres. La mise en entrée est pratique politique. Ou encore, suivant Eduardo Guimarães (2002) lorsqu’il nous parle de la notion du politique « comme une chose qui est propre à la dimension qui affecte matériellement le langage » (idem, p. 15), je comprends la mise en entrée comme le produit de la division des sens qui s’inscrit dans la langue, ce qui aboutit à la formulation : inscription de mots, de syntagmes, d’expressions et même d’énoncés comme entrées dans des instruments linguistiques. Cette réflexion découle du fait que tout ce qui se dit ou ce qui s’entend n’est pas susceptible de devenir une entrée dans des instruments linguistiques. Autrement dit, la langue dépasse tout dictionnaire ou tout processus de dictionnarisation[9] (Medeiros, 2024a).
La mise en entrée renvoie donc au fait d’opérer une sélection, dans la chaîne signifiante, qui devient entrée dans les instruments linguistiques. Un processus ayant une historicité et sujet à des injonctions coercitives sur les formes de sélection. Les interrogations qui concernent l’instrument linguistique en question sont : dans quelle mesure l’historicité de cette forme n’aboutit-elle pas à un processus qui empêcherait l’appréhension d’autres signifiants? Dans quelle mesure le principe d’économie en jeu dans la délimitation du syntagme ne fonctionne-t-elle pas de façon à empêcher les entrées dans les dictionnaires et ainsi à empêcher les sens?
En allant plus loin, le processus de mise en entrée est ici compris comme étant soumis à des injonctions idéologiques qui permettent ou non qu’une sélection ou une autre puisse constituer une entrée de dictionnaire. En étant sujette à des conditions de production qui rendent possibles certaines formes et en excluent d’autres des instruments linguistiques. Cela suppose que les sélections de signifiants qui font leur entrée dans les dictionnaires ne sont pas exemptes de positions discursives qui rendent (im)possibles leur entrée. Cela concerne aussi le processus qui institue une chaîne signifiante comme unité[10] dans un instrument linguistique, qu’il s’agisse d’un instrument de référence ou d’un instrument alternatif. Alexandre Soares (2024) distingue la presse traditionnelle de la presse alternative, affirmant que cette dernière « accueille d’autre types de rapports à l’idéologie dominante » (Soares, 2024). Dans cette ligne, je propose de considérer que le Dictionnaire des favelas Marielle Franco est un instrument linguistique alternatif. Je considère également qu’il y a dans la mise en entrée un problème de partage du sensible. Pour Jacques Rancière le « partage du sensible » est « ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en même temps l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives. Un partage du sensible fixe donc en même temps un commun partage et des parts exclusives » (Rancière, 2000, p. 12).
Dans ce livre, Rancière (2000) continue sa réflexion en évoquant ce que serait le citoyen : « Le citoyen, dit Aristote, est celui qui a part au fait de gouverner et d’être gouverné » (p. 12, italique de l’auteur). Et il nous avertit avec une adversative : « Mais une autre forme de partage précède cet avoir part : celui qui détermine ceux qui y ont part. L’animal parlant, dit Aristote, est un animal politique. Mais l’esclave, s’il comprend le langage, ne le “possède” pas. » (p. 12-13, guillemets de l’auteur) La notion de partage du sensible nous fait comprendre qu’un commun instaure des espaces de gouvernance et de gouvernés. Ceux qui ont été précédemment exclus, ceux qui ne possèdent pas de « langue », n’ont pas part à ces espaces. Le partage du sensible, écrit encore Rancière, « fait voir qui peut avoir part au commun en fonction de ce qu’il fait, du temps et de l’espace dans lesquels cette activité s’exerce » (p. 13), « définit ainsi des compétences ou des incompétences au commun » et « définit le fait d’être ou non visible dans un espace commun, doué d’une parole commune, etc. » (p. 13). Suivant Rancière, j’estime qu’on peut comprendre un dictionnaire de référence tel que le Houaiss comme un objet qui active un registre d’instauration du commun, du visible et de l’invisible, des espaces où l’on gouverne et où l’on est gouverné. Suivant cette logique, je comprends la mise en entrée comme le fruit d’une division que Rancière signale à partir du commun. Un commun qui assourdit ou non les instruments linguistiques, un commun que d’autres instruments, fruits d’un engagement et/ou de production de/dans des espaces[11] périphériques par des personnes y habitant, des « individus périphériques », peuvent ou non (d)énoncer et éclairer. La notion d’ « individus périphériques » (sujeitas e sujeitos periféricos) nous vient de Tiaraju (2022). Il s’agit d’une notion ancrée dans les études de base matérialiste. Ces individus sont ici compris comme les « fruits d’une condition historique et des rapports sociaux qui les précèdent » (Tiaraju, 2022, p. 225).
Un instrument linguistique sur les réseaux : le Dictionnaire Marielle Franco
Le Dictionnaire Marielle Franco est un wiki au fonctionnement encyclopédique, dans la mesure où l’on y trouve des méta-savoirs, c’est-à-dire des savoirs qui ne se restreignent pas aux savoirs sur le langage (cf. Esteves, 2014, 2017). On y trouve aussi des savoirs métalinguistiques, ce qui le rapproche des dictionnaires. Intitulé Dictionnaire des favelas Marielle Franco, cet instrument bénéficie du soutien institutionnel de la Fiocruz[12]. Le nommer dictionnaire[13] inscrit cet objet discursif dans une tradition dictionnairique. En allant plus loin, le nommer dictionnaire instaure un lieu du dire qui fonctionne comme représentation de la langue (sur la représentation de la langue, voir Collinot et Mazière, 1997, p. 16). On ne peut pas perdre de vue que le nom dictionnaire a une longue historicité de légitimation en tant que lieu de fabrique de la langue (Auroux, Mazière, 1996). En effet, le nom dictionnaire active la mémoire d’un espace en relief dans notre formation sociale en ce qui touche à la langue.
Le Dictionnaire des favelas Marielle Franco a ses propres règles explicites sur sa plateforme. Concernant la mise en entrée, il existe une page spécifique intitulée « Définition et types d’entrées », sur laquelle apparaissent les onglets « Qu’est-ce qu’une entrée », « Types d’entrées », « Que doit-il y avoir dans une entrée? », « Axes d’analyse », « Autour des orientations éthiques » et également des liens dirigeant vers « Participer » et « Règles éditoriales ». En résumé, dans cet instrument, on comprend que les « entrées » « constituent des manifestations d’auteurs et autrices sur les favelas et les périphéries urbaines », comme on peut le voir ci-dessous.
Figure 1 : Capture d’écran de l’onglet « Définition et types d’entrées ».

Source : https://wikifavelas.com.br/index.php/Wikifavelas:Defini%C3%A7%C3%A3o_e_tipos_de_verbetes. (15 août 2024)
Comme nous pouvons le lire ci-dessus, les règles indiquent dans « Que doit-il y avoir dans une entrée? » qu’il est nécessaire d’indiquer l’auteur·trice. Cette indication est fondamentale et nous pouvons lire en dessous du titre « Définition et types d’entrées » : « Auteur : équipe du Dictionnaire des favelas Marielle Franco ». Les noms des membres de l’équipe apparaissent sur la page consacrée à l’équipe. Il s’agit d’un instrument dont les entrées fonctionnent sur le registre de la responsabilité. Dans les entrées, la ou les signature(s) renvoie(nt) au(x) auteur(s) ou autrice(s) qui prennent la responsabilité du dire. La définition de l’entrée ci-dessus précise les espaces vers lesquels se tourne ce dictionnaire : les favelas et les périphéries urbaines. Les espaces urbains à la marge des centres urbains. Les marges spatiales et sociales souvent internes aux quartiers, comme c’est le cas des favelas de Rio de Janeiro.
Dans un autre travail, j’ai mené une réflexion autour de la position du lexicographe (cf. Medeiros, sous presse). Ici, je dirai que le Dictionnaire Marielle Franco assume un rôle de lexicographe inscrit dans d’autres espaces sociaux, c’est-à-dire venant d’espaces sociaux périphériques, une position qui s’exprime également par les sélections devenues entrées. L’analyse des entrées que je propose dans cet article fait suite aux études que j’ai réalisées sur la désignation des individus dans cet instrument linguistique. Avant de continuer, il est nécessaire d’exposer ce qu’on entend par « désignation » dans le domaine où se situent les réflexions de cet article. Dans le sillage de Verli Petri (2008), la désignation est comprise comme
[…] un mot, un terme ou une expression qui produit l’effet de nommer, indiquer, qualifier quelque chose ou quelqu’un (Guimarães, 1995; 2001). […] nous voyons l’acte de désigner comme une forme synonymique de l’acte de nommer, considérant que cet acte a aussi pour propriété de formaliser l’existence de quelque chose ou de quelqu’un, y compris juridiquement, ce qui permet de déclencher un processus de désidentification et, par conséquent, de différenciation (Petri, 2008, p. 232, italique de l’autrice).
Les désignations (d)énoncent les rapports de force qui s’inscrivent dans l’acte de nommer. Elles construisent des référents, compris discursivement comme des constructions symboliques qui produisent des sens. Elles agissent sur les processus de subjectivation des individus et, en ce sens, produisent des identifications, contre-identifications et désidentifications. Soulignons que les désignations ici prises en compte ne concernent pas un registre plus ou moins soutenu, mais la mise sous silence de certaines entrées dans les dictionnaires de référence, comme c’est le cas du Houaiss. Par exemple, des entrées comme élément suspect, impliqué (envolvido), disparition forcée (desaparecimento forçado) et survivant de prison (sobrevivente de cárcere) sont des signifiants qui se réfèrent aux personnes vivant dans des périphéries urbaines dans des conditions de violence, exercée par des forces qui incluent celles de l’État. Ce sont des signifiants qui renvoient, comme le montre par exemple l’Observatoire national de la sécurité[14], aux corps de personnes jeunes et noires. Ce sont des signifiants qui énoncent le racisme structurant de la société (Mbembe, 2018). Dans d’autres travaux, j’ai travaillé sur deux d’entre eux : élément suspect (Medeiros, 2024a) et impliqué (Medeiros, 2024b). Dans cet article, qui propose d’étoffer la notion de mise en entrée et de réfléchir au rôle du lexicographe en lien avec la notion de prise de parole, je me penche sur survivant de prison et disparition forcée. Ce sont, de nouveau, des entrées qui n’apparaissent pas dans les dictionnaires de référence brésiliens, comme le Houaiss.
Dans le Houaiss, nous trouvons les entrées survivant et prison. Le premier nous propose la définition « ce qui ou celui qui survit ou a survécu » et ne fait pas allusion aux individus en question ici. La deuxième entrée se limite aux lieux. Une observation : nous ne traiterons pas ici des questions sur l’inclusion de syntagmes dans les dictionnaires de référence. Le cœur de ce travail porte sur l’apparition de syntagmes qui se rapportent à la dénomination/désignation d’individus dans le Marielle Franco. L’entrée survivant de prison est composée de trois parties : la première, où se trouve la définition signée; la deuxième, nommée « concept »; la troisième, intitulée « voir aussi », qui comporte des liens vers deux textes.
Figure 2 : Capture d’écran de l’onglet présentant l’entrée « survivant de prison ».
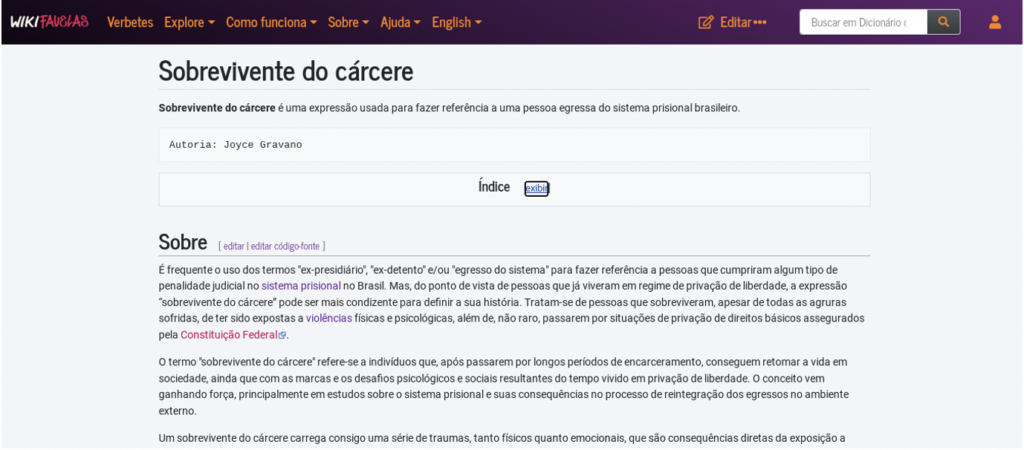
Source : https://wikifavelas.com.br/index.php/Sobrevivente_do_c%C3%A1rcere. (août 2024)
La définition – « “survivant de prison” est une expression utilisée en référence à une personne sortie du système carcéral brésilien » – signale qu’il s’agit d’une expression, une manière de se référer à « une personne sortie du système carcéral ». C’est dans ce qui est indiqué comme « concept » que nous trouvons les trois désignations concurrentes : « Il est fréquent d’utiliser les termes “ex-prisonnier”, “ex-détenu” et/ou “sorti du système” en référence aux personnes ayant purgé une peine judiciaire dans le système carcéral au Brésil. […] » (le texte contient des guillemets et des hyperliens vers la plateforme).
Dans « Concepts » apparaissent trois dénominations présentées comme courantes : ex-prisonnier, ex-détenu et/ou sorti du système. Les deux premières, non verbales, indiquent un lieu (la prison) et une action (détenir). En revanche, la troisième – sorti du système – instaure une lacune – quel système? – à laquelle on répond par la définition : carcéral. Dans « Concepts » on trouve donc deux positions discursives : celle de l’autre, c’est-à-dire de ceux qui ne sont pas dans cette situation, à savoir : « Il est fréquent d’utiliser les termes “ex-prisonnier”, “ex-détenu” et/ou “sorti du système” en référence aux personnes ayant purgé une peine judiciaire dans le système carcéral au Brésil […] ». Et celle introduite par une adversative (« mais »), qui signale la position d’un individu ayant déjà vécu en prison et en étant sorti : « Mais, du point de vue des personnes ayant déjà vécu en régime de privation de liberté, l’expression “survivant de prison” peut être plus appropriée pour définir leur histoire ». Dans l’une, on parle de la prison, de la détention et du système. Dans l’autre, on parle de la survie dans des endroits où les droits fondamentaux de la Constitution ne sont pas assurés. On parle d’un endroit d’absence de droits, d’absence de citoyenneté.
Dans « Voir aussi », il y a également un mécanisme qui fonctionne comme une forme de renvoi (autour du renvoi, cf. Petri et Pengo, 2022) dans ce cas vers deux textes qui touchent aux questions particulièrement problématiques au Brésil que sont la reconnaissance faciale dans l’emprisonnement des corps et le processus de désincarcération à partir d’un mouvement social. En somme, l’entrée survivant de prison reprend des désignations courantes de notre quotidien et, avec elles, énonce des formes de vie sans espace dans la société.
Disparition forcée ne touche pas exactement à la désignation d’individus, mais se réfère au processus de disparition d’individus. Elle touche des individus qui dénoncent les pratiques nécropolitiques sur les corps périphériques.
Figure 3 : Capture d’écran de l’onglet présentant l’entrée « disparition forcée »
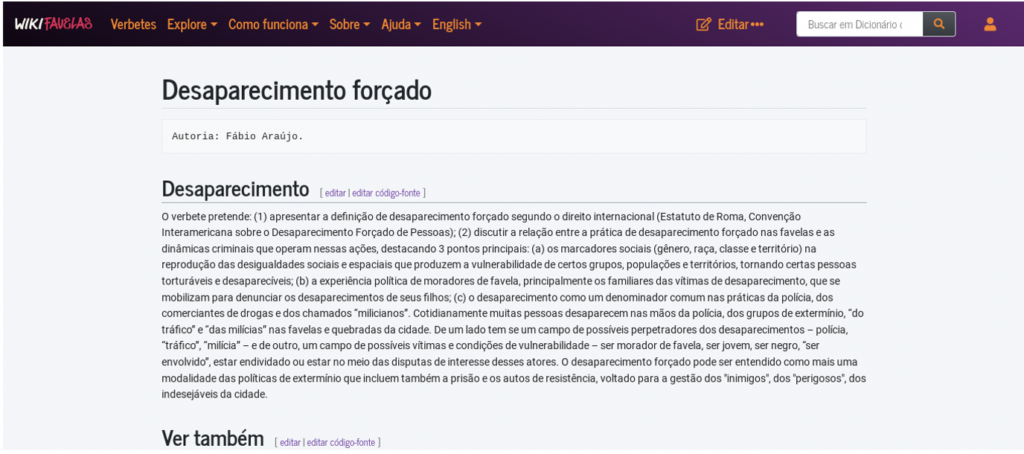
Source : https://wikifavelas.com.br/index.php/Desaparecimento_for%C3%A7ado. (août 2024)
Cette expression circule dans différents médias et se trouve sur Wikipédia[15], où nous lisons que « selon la législation internationale des droits humains, la “disparition forcée” est une forme d’arbitraire étatique » et, entre autres considérations, qu’« il s’agit d’une pratique sanctionnée par le droit international en tant que crime contre l’humanité et [qu’]il est considéré comme une des plus graves violations des droits humains ». Un crime, ajoutons, qui n’est pas sujet à la prescription. Dans ce même instrument, nous trouvons que, « en général, les disparitions forcées sont utilisées comme moyens de répression d’État contre des opposants politiques, contre des criminels supposés ou même contre des personnes qui dérangent le groupe au pouvoir ». On trouve également des références à des études et actes nationaux et internationaux relatifs à cette pratique.
Dans le Dictionnaire Marielle Franco, nous trouvons un autre format pour cette entrée. Pas une entrée qui présente une définition, comme nous l’avons vu pour survivant de prison, mais l’énonciation d’un projet d’entrée – « L’entrée vise à […] » – qui se décline en deux points. Dans le premier, on propose de « présenter une définition de “disparition forcée” selon le droit international ». Dans le deuxième, on annonce qu’on entend discuter « la relation entre la pratique de la disparition forcée dans les favelas et les dynamiques criminelles qui exercent ces actions en mettant en évidences trois points ». Le premier point implique les marqueurs sociaux de genre, de race, de classe et de territoire pour la pratique de la disparition forcée. Le deuxième point met en évidence l’« expérience politique des habitants des favelas » face à la pratique de la disparition de leur enfant. Le troisième point met en scène des groupes portant ces pratiques, à savoir, la police, les vendeurs de drogues et la « milice »[16]. En bref, dans le Dictionnaire des favelas, disparition forcée met en scène le territoire de la favela, indique qui pourrait être porté disparu de force et les « conditions de vulnérabilité – habiter une favela, être jeune, être noir, “être impliqué”, être endetté ou se trouver au milieu des disputes d’intérêt de ces acteurs » (les guillemets sur « être impliqué » correspondent à l’entrée dans le dictionnaire) et, enfin, signale que la disparition forcée « peut être comprise comme une autre des modalités d’extermination qui comprennent également la prison et les actes de résistance, tournée vers la gestion des “ennemis” des “dangereux”, des indésirables de la ville ». En résumé, disparition forcée opère dans la même classe d’entrée que élément suspect, impliqué, survivant de prison, en ce qu’elles permettent les mêmes paraphrases qui enlèvent aux individus leur condition de citoyen·ne. Dit d’une autre manière, ce sont des entrées qui portent sur la dénomination des individus susceptibles d’être la cible de balles, d’exécution, d’extermination. Ce sont des corps périphériques. Ce sont, surtout, des corps de jeunes Noirs.
Forcée, dans l’entrée disparition forcée, instaure des lacunes qui posent des questions criantes – forcée par qui? forcée pourquoi? – qui nous parlent de l’omission des auteurs et de la mise sous silence de ce qui motive la pratique de la disparition forcée. Forcée nous hurle le non-dit, connu, de ceux qui peuvent être portés disparus et des raisons de telles pratiques. C’est une désignation qui a une longue historicité dans notre formation sociale. Le livre Disparition forcée, débute ainsi son introduction :
La Baixada Fluminense[17], depuis sa phase coloniale, a toujours cohabité avec les assassinats et les occultations de cadavres. Il en a été ainsi avec les Jacutingas et les Traitapongas, avec les groupes indigènes décimés par les grands propriétaires de plantations à travers leur bras armé, avides de terres, de richesses et de potentiel productif, toujours protégés par la couronne (Souza et Ribeiro, 2021). […] Quand ces personnes noires ont été expulsées, sans qualification et propriété sur le marché du travail capitaliste non esclavagiste, elles ont été la cible de disparitions orchestrées par les détenteurs du pouvoir, qui voyaient dans cette stratégie une possibilité de réduire d’éventuels dommages économiques, juridiques et sociaux (Araújo, Alves, Pinto, 2023, p. 11).
Ce livre est le résultat d’un projet sur les corps disparus, « insépultables », tel que qualifiés dans un des chapitres. Disparition forcée, dénomination qui circule dans notre société, est la typification d’un crime. Tout comme élément suspect, on sait qui sont les corps qui disparaissent sans même avoir le droit à un enterrement. Ils sont déjà connus et un dictionnaire des favelas, comme le Dictionnaire Marielle Franco, jette la lumière sur eux, dans ses entrées, et les retire du silence sur lequel reposent les pratiques d’élimination de l’autre.
Pour une continuité
Retournant à la distinction entre savoirs assujettis et savoirs qui assujettissent, nous dirons que dans survivant de prison, on trouve un signifiant portant des savoirs qui assujettissent les individus des périphéries[18]. Disparition forcée touche aussi les individus des périphéries, mais de manière différente. Disparition forcée désigne une pratique/un processus d’extermination et, en ce sens, il touche des corps disparus. En d’autres mots, en nommant une pratique, un processus consistant à faire disparaître des personnes, il fonctionne comme un acte de désignation des corps disparus qui les réduit au silence, étant « porté disparu ». Survivant de prison et disparition forcée sont des signifiants tus dans les instruments linguistiques de référence pour parler de la langue, et avec elle, parler des individus. Ce sont des désignations qui n’apparaissent pas dans un grand dictionnaire de référence comme le Houaiss, bien qu’ils soient courants dans notre société.
Le processus de dictionnarisation consiste à rendre des entrées signifiantes en circulation. Nous savons cependant qu’un dictionnaire n’enregistre pas tout. Mais nous pouvons nous demander : quelles conséquences sociales amène le fait de ne pas tout enregistrer? Quels sont les effets des savoirs qui assujettissent sur la désignation des sujets? Quels sont les effets de la mise sous silence de tels signifiants sur notre formation sociale?
Enfin, cette réflexion donne suite à une autre notion qui nous vient d’Orlandi (2009) : la décolonisation linguistique. Cette notion renvoie à la question de l’auteur dans la production de discours sur la langue pour les Brésiliens, dans la production de grammaires « écrites par des Brésiliens pour des Brésiliens » (2009, p. 175). Cela a représenté un processus important, qui a commencé au début du XIXe siècle, face à la production de discours sur la langue portugaise au Portugal. Il me semble important de considérer que ce processus n’a pas été le geste de n’importe quels Brésiliens : il a été produit par une élite lettrée (cf. Medeiros, Bonfante et Esteves, 2023). En d’autres mots, il s’agissait d’un projet de l’élite brésilienne visant à promouvoir un projet national d’identité et de langue, y compris pour faire face au colonisateur.
Nous sommes au XXIe siècle. Les instruments linguistiques ne circulent pas seulement sur Internet, ils y sont produits. Nunes nous interroge dans un de ses textes : « Si les dictionnaires brésiliens du XXe siècle consolident un imaginaire de la langue nationale, ne serait-il pas temps de nous tourner vers la réalité des villes, qui nous touche plus immédiatement dans notre quotidien? » (Nunes, 2001, p. 179). C’est bien à partir de ce constat que je me demande ce que permet un instrument comme le Dictionnaire des favelas Marielle Franco.
Le point important ici est que nous sommes à une époque différente, différente de celle vers laquelle l’autrice citée se tourne. Nous sommes à une époque où les positions discursives mises sous silence prennent la parole et élaborent des instruments linguistiques. Dans laquelle un supposé « silence bavard » insiste à se faire entendre et à se faire inscrire dans le dire sur la langue et sur les savoirs dans les instruments linguistiques. Je considère que l’instrument linguistique en question se situe dans un mouvement de reconnaissance de la puissance intellectuelle des individus des périphéries et de leurs espaces territoriaux. Ce mouvement passe par la dénonciation des actions subies par ces corps périphériques, par la désignation des individus et sa resignification, par la formulation de concepts, par la langue. Un mouvement qui accueille la diversité et instaure d’autres dires sur les savoirs. Il s’agit donc de considérer, suivant Collinot et Mazière (1997), que les instruments linguistiques sont des instruments historiques, capables de ruptures et d’innovations. Instruments capables, je dirais, de revoir une historicité de la connaissance en y inscrivant d’autres formes de savoirs.
Références bibliographiques
Araújo, Adriano, Alvez, José Cláudio Souza, Gomes, Jaqueline de Sousa, Pinto, Nalayne Mendonça (orgs.). 2023. Desaparecimento forçado: vidas interrompidas na baixada fluminense. RJ: Autografia.
Auroux, Sylvain. 1992. A revolução tecnológica da gramatização (trad. Eni Orlandi). Campinas, São Paulo: Unicamp.
Auroux, Sylvain, Mazière, Francine. 2006. Hyperlangues et fabriques de langues. Histoire, Épistémologie, Langage, 28.
Authier, Jacqueline. 1995. Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coincidence du dire. Paris : Larousse.
Baronas, Roberto. 1997 [1971]. Análise do discurso: apontamentos para uma história da noção-conceito de formação discursiva. São Carlos: Pedro & João.
Cestari, Mariana J. 2017. Por uma tomada de posição feminista e antirracista na Análise de Discurso. In Zoppi Fontana, Mónica; Ferrari, Ana Josefina (org.). Mulheres em discurso: identificação de gênero e práticas de resistência (183-203). Campinas : Pontes.
Collinot, André, Mazière, Francine. 1997. Un prêt à parler : le dictionnaire. Paris, PUF.
Collins, Patricia Hill. 2019. Pensamento feminista negro (trad. Jamile Pinheiro Dias). SP: Boitempo.
Esteves, Phellipe Marcel. 2017. Discurso sobre alimentação nas enciclopédias do Brasil. Niterói: EDUFF.
Freitas, Ronaldo. 2020. Instrumentação linguística em rede: análise discursiva de dicionários on-line. Tese de doutorado, Niterói: UFF. https://app.uff.br/riuff/handle/1/23465
González, Lélia. 2020 [1979]. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In González, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. Rio de Janeiro: Zahar, https://app.uff.br/riuff/handle/1/23465
Guimarães, Eduardo. 1995. Os limites do sentido. Campinas: Pontes.
Guimarães, Eduardo. 2001. Um mapa e suas ruas. In Orlandi, Eni Pulcinelli (org.). Cidade atravessada: os sentidos públicos no espaço urbano (95–100). Campinas: Pontes.
Guimarães, Eduardo. 2002. Semântica da enunciação. Campinas: Pontes.
Mbembe, Achille. 2018. Necropolítica (trad. Renata Santini). SP: n-1 edições.
Medeiros, Vanise. 2024a. Instrumentos na rede: por uma ética do pertencimento. In Rasia, Gesualda; Negri, Lígia, Rodrigues, Patrícia (org.). CELSUL 25 anos: práticas linguageiras e gramaticais (323-338). Campinas, SP: Mercado de Letras.
Medeiros, Vanise. 2024b. Sentido literal é efeito de sentido: reflexões em torno da verbetização em instrumentos linguísticos contemporâneos. In Mariani, Bethania, Rodrigues, Andréa, Dias, Juciele, Fragoso, Élcio. “A linguagem e seu funcionamento funcionamento” 40 anos… e mais (408-421). Rio de Janeiro: Edições Makunaima.
Medeiros, Vanise. Considerações acerca do conhecimento: saberes subjugados e saberes que subjugam (sous presse).
Medeiros, Vanise; Bonfante, Gleiton. Matheus; Esteves, Phellipe Marcel da Silva. 2023. Descolonização e decolonialidade: considerações sobre línguas no espaço brasileiro.
Todas as Letras – Revista de Língua e Literatura, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 1-17, mai./ago 2023.
Modesto, Rogério. 2021. Os discursos racializados. Revista da Abralin, v. 20, n. 2, p. 1-19.
Moura, Jonathan Ribeiro Farias de. 2018. Da sombra às cores: análise discursiva do Dicionário LGBTS Aurélia. Tese de doutorado, UFRJ.
Moura, Jonathan Ribeiro Farias de. 2020. A verbetização em redes sociais: o processo discursivo diferente da dicionarização. Revista Policromias, n. 2. https://ppglinguistica.letras.ufrj.br/document/da-sombra-as-cores-analise-discursiva-do-dicionario-lgbts-aurelia/
Nunes, José Horta. 2001. Um espaço ético para pensar os instrumentos linguísticos: o caso do dicionário. In Orlandi, Eni (org.) Política linguística no Brasil (163-181). Campinas, SP: Pontes.
Nunes, José. Horta. 2006. Dicionários no Brasil: análise e história do século XVI ao século XIX, Campinas: Pontes, SP: Fapesp, São José do Rio Preto, SP: Fapesp.
Nunes, José. Horta. 2013. A invenção do dicionário brasileiro: transferência tecnológica, discurso literário e sociedade. Revista de Historiografia Linguística 2, p. 159-172.
Nunes, José Horta. 2024. O Dicionário de Sinônimos de Antenor Nascentes:
formatos discursivos de verbetes. In Pfeiffer, Claudia Castellanos, Costa, Thais, Medeiros, Vanise. Para uma História das ideias linguísticas de Antenor Nascentes (149-163). São Carlos: Pedro& João.
Orlandi, Eni (org.), 2001. História das idéias políticas: construção do saber metalingüístico e constituição de língua nacional. Campinas: Pontes, Cáceres: UNEMAT.
Orlandi, Eni. 2002. Língua e conhecimento linguístico: para uma História das Ideias no Brasil. SP: Cortez.
Orlandi, Eni. 2009. Processo de descolonização linguística e lusofonia. In Orlandi, Eni (org.). Língua brasileira e outras histórias (171-180). Campinas: RG.
Pêcheux, Michel. 1990 [1982]. Delimitações, inversões, deslocamentos (trad. José Horta Nunes). Caderno de Estudos Linguísticos 19, p. 7-24.
Pêcheux, Michel (Texto assinado pelo pseudônimo Thomas Herbert). 2011 [1966]. Reflexões sobre a situação teórica das ciências sociais e, especialmente, da psicologia social (trad Mariza Vieira da Silva, Laura Perrella Parisi). In Orlandi, Eni. Análise de discurso: Michel Pêcheux. Textos selecionados (21-53). Campinas: Pontes.
Petri, Verli. 2008. A produção de efeitos de sentidos nas relações entre língua e sujeito: um estudo discursivo da dicionarização do “gaúcho”. Revista Letras, v. 18, n. 2, p. 227–243.
Petri, Verli, Pengo, Carla. 2021. A história das palavras “justiça” e “anistia” e seus respectivos funcionamentos no discurso político brasileiro do século XXI. Caderno de Letras, vol. 1, p. 441-460.
Rancière, Jacques. 2020. A partilha do sensível (trad. Monica Costa Neto). São Paulo: editora 34 Letras, 2. ed.
Rancière, Jacques. 2000. Le partage du sensible. Esthétique et politique. Paris : La Fabrique-éditions.
Rodriguez-Alcalá, Carolina. 2011. Discurso e Cidade: a linguagem e a construção da “evidência de mundo”. In Rodriguez, Eduardo, Santos, Gabriel Leopoldino, Castello Branco, Luiza Katia Andrade (orgs.). Análise de discurso no Brasil: pensando o impensado sempre (243-258). Campinas SP: Editora RG.
Rodriguez-Alcalá, Carolina, Sobrinho, Helson Flávio da Silva. 2023. Condições de produção do discurso: a relação entre a língua e sua exterioridade na dialética materialista. In Grigoletto, Evandra et alii. (org.). Trajetos de sujeitos e sentidos: discurso, história, revolução (57-90). Campinas: Pontes.
Soares, Alexandre Ferrari. 2024 (no prelo). A imprensa alternativa digital: sentidos e efeitos de independência (produção/manutenção da autoimagem). XI SEAD.
Souza, Marlúcia Santos de, Ribeiro, Simone Orlandi. 2021. Memórias Ancestrais no Norte e Oeste das Cercanias da Guanabara. Revista Pilares da História, 20, n. 19, p. 37-45.
Tiaraju, Pablo D´Almeida. 2022. A formação das sujeitas e dos sujeitos periféricos. SP: Dandara.
Zoppi-Fontana, Monica, Ferrari, Ana Josefina. 2017. Apresentação. Uma análise discursiva das identificações de gênero. In Zoppi-Fontana, Monica, Ferrari, Ana Josefina (org.). Mulheres em discurso: identificações de gênero e práticas de resistência, Vol. 2 (7-20). Campinas: Pontes Editores.
Zoppi-Fontana, Monica, Fontana, Larissa Silva. 2023. Corpo, gênero e raça: reflexões sobre uma abordagem discursiva do corpo. In Ferreira, Maria Cristina Leandro, Vinhas, Luciana (orgs). O corpo na Análise do Discurso: conceitos em movimento (57-87). Campinas: Pontes.
Sitographie
Dicionário de Favelas Marielle Franco: www.wikifavelas.com.br
Dicionário Houaiss: https://houaiss.uol.com.br/houaisson/apps/uol_www/vopen/html/inicio.php//
- Dans l'ensemble de son article, l'autrice emploie ce terme en référence à son usage en psychanalyse lacanienne (N. de la R.) ↵
- Seuls deux textes sont mentionnés, malgré les nombreux autres d’Auroux, d’Orlandi et d’autres écrits d’autres penseurs et penseuses du domaine de l’histoire des idées linguistiques en France et au Brésil. ↵
- Dans le cadre de mes travaux, il faut prendre en compte mes lectures du Dictionnaire des favelas Marielle Franco ainsi que mes lectures de notes de bas de page, de glossaires et vocabulaires brésiliens des XIXe et XXIe siècles qui permettent d’observer le processus d’instauration des entrées de dictionnaire. ↵
- N.T. : Le nom Aurélia fait référence au dictionnaire Aurélio, un dictionnaire de langue portugaise publié et amplement utilisé au Brésil. Le remplacement de la lettre finale « o », marque du masculin, par « a », marque du féminin, indique une féminisation en portugais. ↵
- LGBTQIAP+ : sigle désignant les personnes qui se situent hors des normes traditionnelles de genre et de sexualité : Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuais, Pansexuais, le "+" représentant d’autres identités. ↵
- Cette référence à Nunes se trouve dans Moura (2020). ↵
- Fruit d’un travail présenté au IVe GAL (2024) et transformé en article, sous presse. ↵
- Medeiros (2024a, 2024b). ↵
- Définition présentée au CELSUL, en 2022, et publiée (Medeiros, 2024a). ↵
- Concernant l’unité linguistique, Carolina Rodriguez-Alcalá évoque l’unité d’une pratique empirique grammaticale (conversation privée, 2024). ↵
- La réflexion sur l’espace se retrouve chez Rancière (2000), mais il est également nécessaire de mentionner les textes de Rodriguez-Alcalá (2011, entre autres), où la question du sujet/espace est fondamental, comme dans la note 13 de l’article de Carolina Rodriguez-Alcalá et Helson Sobrinho (2023) : « En tant que geste épistémologique, le matérialisme interroge l’opposition positiviste classique sujet/objet (espace, monde). C’est pour cela que, dans une perspective discursive matérialiste, nous disons que sujets et espaces se constituent dans un même mouvement historique de sens, qu’il y a entre les sujets, le sens et l’espace une relation constitutive » (Rodriguez-Alcalá et Sobrinho, 2023, p. 71). ↵
- La Fiocruz (Fondation Oswaldo-Cruz) est une institution localisée à Rio de Janeiro, liée au gouvernement fédéral brésilien, qui soutient la recherche dans le domaine de la santé publique. ↵
- Dans d’autres articles (2024a, 2024b), j’ai analysé le terme favela et le nom Marielle Franco. ↵
- Disponible sur : https://observatoriodefavelas.org.br/caminhos-para-reducao-da-violencia-letal-contra-jovens-no-brasil/;. On trouve ces informations dans l’Atlas de la violence et elles circulent au Sénat. Disponible sur : https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2024/06/24/pessoas-negras-sao-maioria-das-vitimas-de-homicidio-revela-atlas-da-violencia. Accès le 29 août 2024. ↵
- Disponible sur : https://pt.wikipedia.org/wiki/Desaparecimento_for%C3%A7ado. Accès : 15 août 2024. N.T. : l’article existe aussi en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Disparition_forc%C3%A9e. Accès le 4 avril 2025. ↵
- Milice se trouve entre guillemets. Dans l’entrée milice, nous avons « organisations paramilitaires qui impliquent directement des agents liés à l’État », « groupes d’extermination », « partie intégrante des machines politiques agissant sur de vastes zones des grandes villes et métropoles », qui agissent de concertation avec les trafiquants de drogue, et « groupes criminels formés et dirigés par des agents de sécurité de l’État ». Disponible sur : https://wikifavelas.com.br/index.php/Mil%C3%ADcia. Accès : 18 septembre 2024. ↵
- N.T. : la Baixada Fluminense est une vaste zone géographique qui se trouve à la périphérie de la ville de Rio de Janeiro. ↵
- Dans cette catégorie sont également incluses les entrées déjà analysées : élément suspect, impliqué (Medeiros, 2024a, 2024b). ↵
